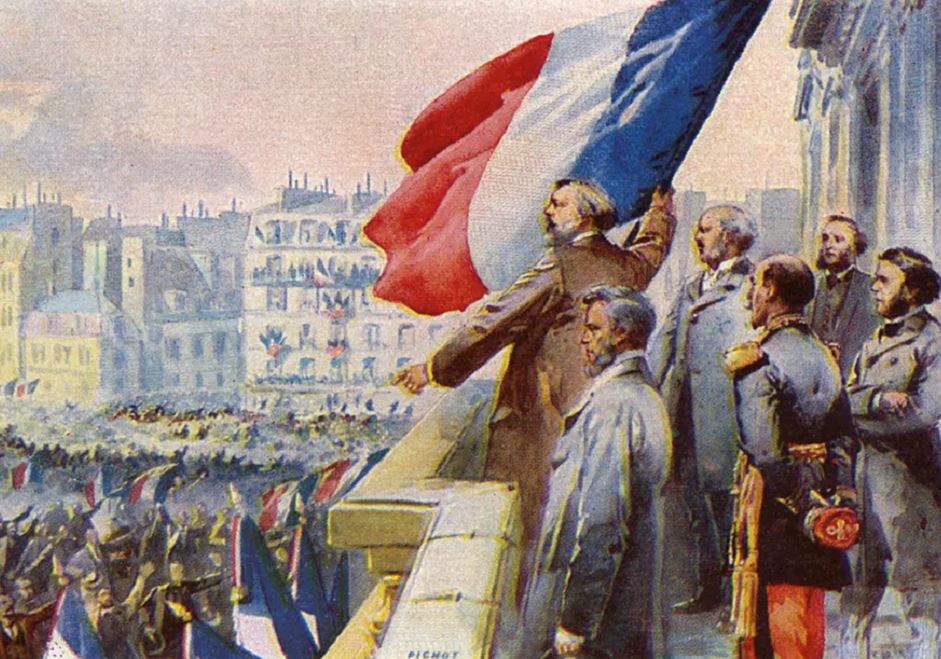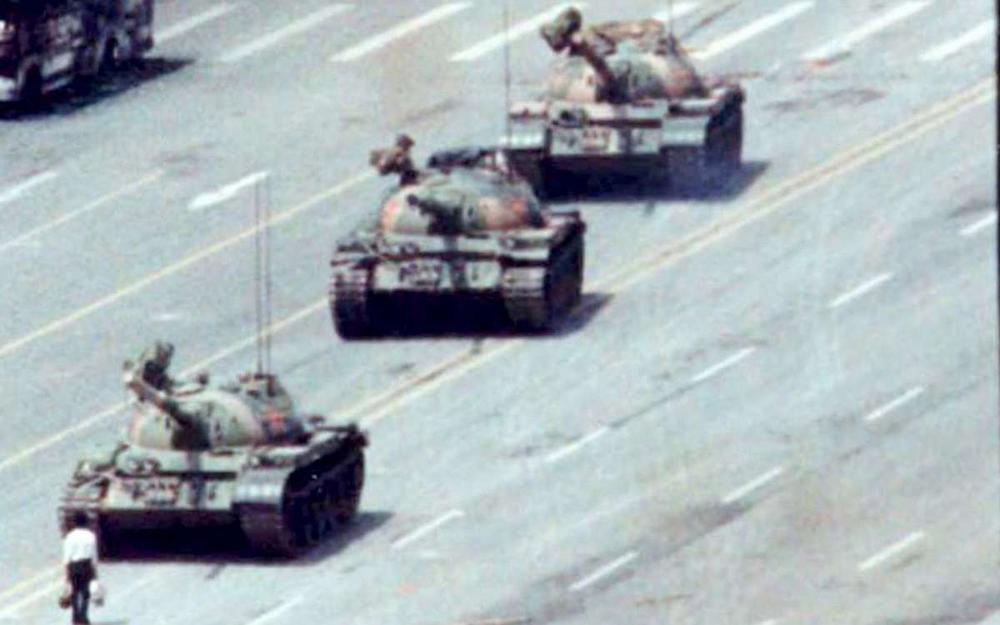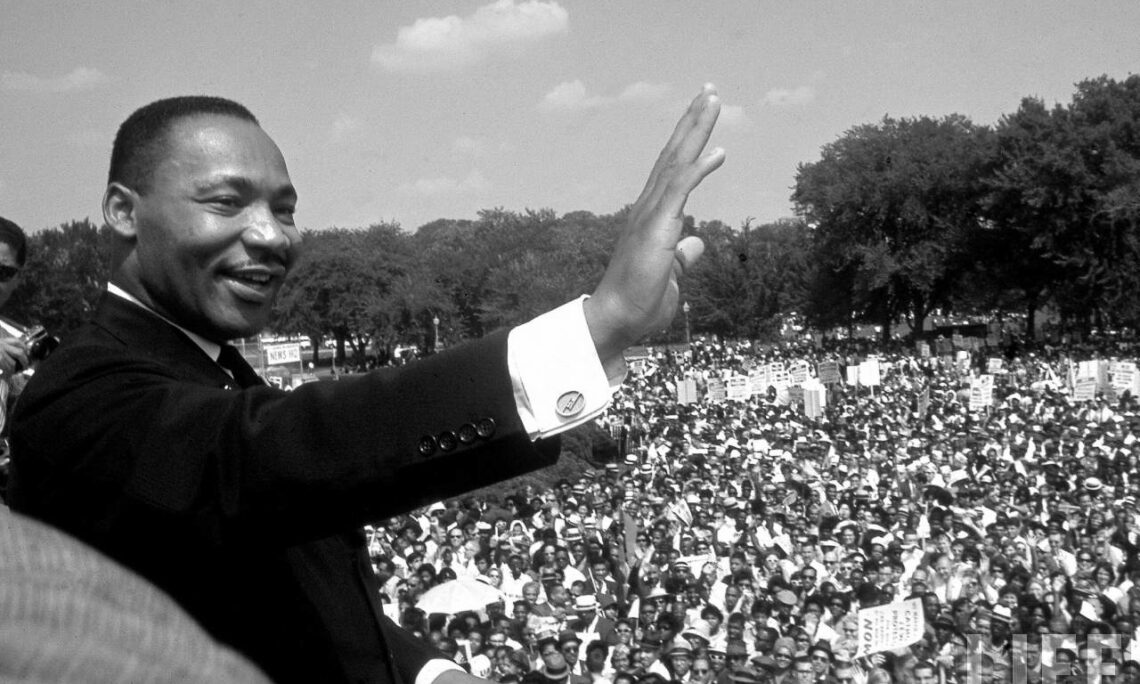Le 18 juillet 1936, une partie de l’armée espagnole se soulève contre la République
Un contexte explosif : tensions sociales, politiques et religieuses
L’instabilité de la Seconde République espagnole La Seconde République, proclamée en avril 1931, promet modernisation, réforme agraire, laïcité et démocratie. Mais elle se heurte à de puissantes résistances : l’Église, les grands propriétaires terriens, l’armée et la monarchie. À gauche, syndicats anarchistes et marxistes trouvent les réformes trop timides. À droite, les conservateurs dénoncent un projet anticlérical et bolchévique. Les élections de février 1936 voient la victoire du Front populaire, une coalition de gauche. L’atmosphère est tendue, les violences politiques se multiplient. L’assassinat du chef monarchiste José Calvo Sotelo le 13 juillet 1936 déclenche l’insurrection tant attendue par les militaires conspirateurs.
Le soulèvement militaire Le 17 juillet 1936, la révolte commence au Maroc espagnol, puis s’étend à plusieurs garnisons d’Espagne. Le 18 juillet, elle prend une ampleur nationale. C’est le début de la guerre civile. Le général Francisco Franco, jusque-là relativement en retrait, devient rapidement le chef incontesté du camp nationaliste.
Deux camps, deux visions irréconciliables
Les Républicains : défense de la démocratie et réformes sociales Le camp républicain regroupe des forces hétérogènes : socialistes, communistes, anarchistes, syndicalistes, républicains modérés. Ils défendent le suffrage universel, la laïcité, les droits des travailleurs, la réforme agraire. Mais cette diversité sera aussi leur faiblesse : divisions internes, luttes intestines, rivalités sanglantes comme à Barcelone en mai 1937. Ils reçoivent un soutien limité de l’Union soviétique et des Brigades internationales, composées de volontaires antifascistes venus du monde entier (notamment français, allemands, américains). George Orwell et Ernest Hemingway feront partie de ceux qui relateront cette guerre au nom de la liberté.
Les Nationalistes : ordre, catholicisme et autoritarisme Franco impose une discipline de fer à une coalition de conservateurs, monarchistes, fascistes (Phalange) et traditionalistes carlistes. Ils prônent le retour à l’ordre, à la foi catholique, à l’unité de l’Espagne, et rejettent toute forme de républicanisme. Le camp nationaliste bénéficie très tôt d’un soutien militaire massif de l’Allemagne nazie (aviation, artillerie) et de l’Italie fasciste (chars, troupes régulières). Ces appuis vont jouer un rôle décisif dans la victoire de Franco.
Une guerre d’une violence inouïe
Bombardements et terreur La guerre civile espagnole est l’un des premiers conflits modernes où les civils deviennent des cibles. Le bombardement de Guernica par l’aviation allemande (Légion Condor) en avril 1937 fait plus de 1 500 morts et traumatise l’opinion internationale. Pablo Picasso en fera une toile symbole de l’horreur. Des massacres de masse sont commis des deux côtés : répression de l’Église et des élites par les Républicains, fusillades et purges systématiques par les Nationalistes. La guerre devient une guerre d’extermination de l’ennemi politique.
Les chiffres de la tragédie Entre 1936 et 1939
- Près de 500 000 morts
- Des centaines de milliers d’exilés vers la France, le Mexique ou l’URSS
- Des villes et villages rasés
- Un traumatisme national durable
Une victoire des Nationalistes, une dictature de 36 ans
La chute de Madrid et la fin du conflit En mars 1939, les Républicains sont vaincus militairement. Le 1er avril 1939, Franco annonce officiellement la fin de la guerre. Il devient le Caudillo (chef) de l’Espagne. Une dictature militaire, catholique et ultraconservatrice s’installe pour plus de trois décennies.
La répression et le silence Les premières années du franquisme sont marquées par une répression féroce : exécutions, emprisonnements, camps de travail. Toute référence à la République est effacée. L’Église retrouve son pouvoir, les langues régionales sont interdites, la censure devient totale. Franco restera au pouvoir jusqu’à sa mort en 1975. La transition démocratique espagnole commencera seulement après cette date.
Une guerre mondiale miniature
Un affrontement idéologique précoce La guerre civile espagnole est souvent considérée comme le prélude de la Seconde Guerre mondiale. Elle oppose déjà fascisme et démocratie, totalitarisme et libertés, propagande et vérité. C’est une guerre où l’aviation, les blindés, la terreur psychologique sont testés grandeur nature.
L’indifférence des démocraties Les démocraties occidentales (France, Royaume-Uni) choisissent une politique de non-intervention, refusant d’aider les Républicains, par peur de provoquer un conflit plus large. Ce silence sera plus tard interprété comme une lâcheté complice. En revanche, les totalitarismes (Hitler, Mussolini, Staline) n’hésitent pas à intervenir massivement. L’Espagne devient un théâtre d’affrontement indirect entre puissances rivales.