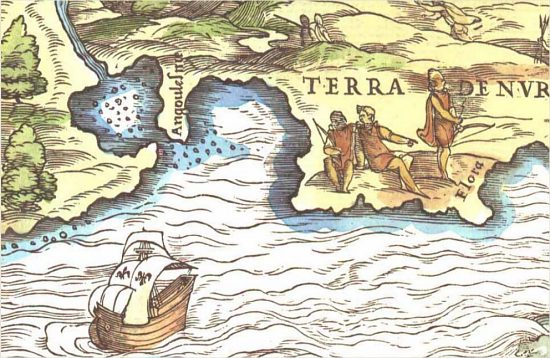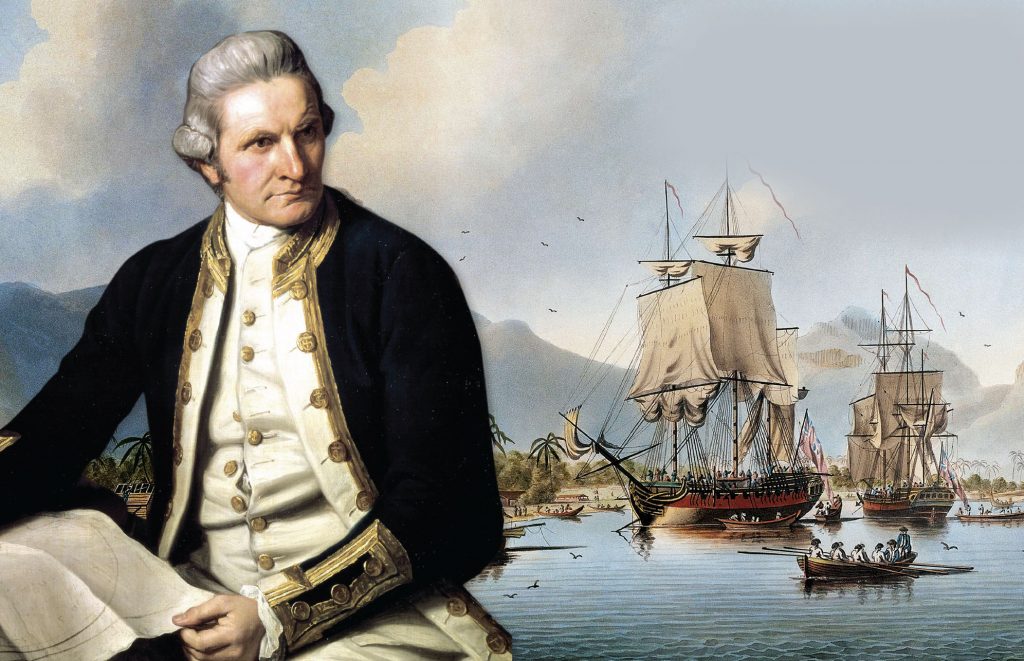Le 16 septembre 1936, l’un des plus célèbres navires de la marine scientifique française, le Pourquoi Pas ?, sombre au large des côtes islandaises dans une tempête dévastatrice
Le Pourquoi Pas ? : un navire de légende
Une naissance au service de la science et de l'exploration Le Pourquoi Pas ? IV est le quatrième navire d'une série portant ce nom, construit à l’arsenal de Saint-Malo en 1908 à l'initiative de Jean-Baptiste Charcot. Il s’agit d’un trois-mâts barque, conçu pour les missions d’exploration polaire et d’observation scientifique. Doté d’un moteur auxiliaire de 450 chevaux, il combine la tradition de la voile et la modernité mécanique. Charcot, fils de l’éminent neurologue Jean-Martin Charcot, s’est détourné de la médecine pour se consacrer à la mer. Passionné d’exploration, il a mené de nombreuses expéditions en Antarctique et dans l’Arctique. Le Pourquoi Pas ? devient rapidement un symbole de la recherche française en milieux extrêmes.
Un palmarès d’explorations prestigieuses Le navire réalise plusieurs missions majeures, notamment
- Une expédition scientifique en Antarctique entre 1908 et 1910
- Des campagnes océanographiques en Atlantique Nord
- Des missions hydrographiques pour la Marine nationale
- Des relevés topographiques en Islande. Jean-Baptiste Charcot n’était pas seulement un explorateur ; c’était aussi un savant, un homme rigoureux, admiré par ses pairs. Il disait : "Il faut toujours aller plus loin, c’est ce qui fait avancer la science."
La mission de 1936 : un dernier voyage au service de la science
Un objectif islandais En 1936, Jean-Baptiste Charcot, alors âgé de 69 ans, repart pour une mission scientifique en Islande, pays qu’il connaît bien. Il s’agit d’y effectuer des relevés hydrographiques, météorologiques et océanographiques. L'équipage compte 40 hommes, dont des scientifiques, des marins, des officiers et des techniciens. La mission se déroule sans incident majeur, jusqu’à la veille du retour vers la France.
16 septembre 1936 : la tempête fatale
Une météo défavorable et des décisions cruciales Le Pourquoi Pas ? appareille de Reykjavik dans la nuit du 15 au 16 septembre 1936. La météo annonce une tempête, mais Charcot, pressé de rentrer, prend le risque de mettre le cap sur Saint-Malo. Vers 5 heures du matin, le navire est pris dans une violente tempête au large de la côte sud de l’Islande, près de Borgarfjörður. Les vents atteignent plus de 120 km/h, et la mer est déchaînée. Le navire ne parvient pas à tenir le cap. Il est projeté contre les rochers et se brise rapidement sous les assauts des vagues.
Le bilan : un seul survivant Sur les 41 hommes à bord, un seul survit : le quartier-maître Eugène Gonidec. Gravement blessé, il est recueilli par des pêcheurs islandais au matin. Il témoigne plus tard des derniers instants du navire, de la bravoure des marins, et du calme impressionnant de Charcot, qui aurait dit avant de couler : "Adieu, mes enfants, à bientôt là-haut." Charcot et son équipage sont portés disparus. Leurs corps, pour la plupart, ne seront jamais retrouvés.
Une onde de choc en France et dans le monde
Une nation en deuil La nouvelle du naufrage provoque une onde de choc en France. Jean-Baptiste Charcot était une figure respectée, presque mythique. Le président de la République Albert Lebrun rend hommage à un "grand serviteur de la science et de la patrie". Des cérémonies sont organisées dans tout le pays. Une plaque commémorative est apposée à l’École de médecine navale de Rochefort. Le naufrage du Pourquoi Pas ? marque la fin d’une époque héroïque de l’exploration scientifique française par la mer.
L’Islande se souvient aussi En Islande, l’émotion est vive. Les habitants de Borgarnes, proches du lieu du naufrage, rendent hommage aux marins disparus. Une stèle commémorative est installée en 1956 à l’endroit du drame. Encore aujourd’hui, les Islandais honorent la mémoire de Charcot comme un "ami du Nord".
L’héritage de Charcot et du Pourquoi Pas ?
Une figure fondatrice de l'exploration scientifique française Charcot laisse un héritage immense. Il a contribué à la cartographie de régions encore inconnues à l’époque, et ses travaux scientifiques sont toujours utilisés. Il a aussi inspiré une génération d’océanographes et d’explorateurs français, dont Paul-Émile Victor. Son navire, le Pourquoi Pas ?, reste un symbole de courage, de persévérance et de rigueur scientifique. Il a ouvert la voie à d'autres bâtiments portant le même nom, jusqu’au Pourquoi Pas ? actuel, navire océanographique moderne lancé en 2005.
Une mémoire entretenue En France, plusieurs rues, écoles et navires portent le nom de Charcot. Des expositions lui sont consacrées dans les musées maritimes, et son journal de bord est un témoignage poignant sur l’état d’esprit d’un explorateur du XXe siècle. Un timbre à son effigie a été émis en 1982. Et chaque année, le 16 septembre, les hommages se multiplient pour se souvenir de cet homme qui disait : "Pourquoi pas tenter l’impossible, si c’est pour faire avancer la connaissance ?"
Une tragédie qui forgea la légende de la science maritime française Le naufrage du Pourquoi Pas ? n’a pas seulement coûté la vie à Jean-Baptiste Charcot et à son équipage : il a marqué l’imaginaire collectif comme une fin tragique mais héroïque. Ce drame scelle la légende d’un homme qui, jusqu’à la fin, a mis la science au-dessus de sa propre vie. Il reste une source d’inspiration pour les explorateurs, les marins, et tous ceux qui rêvent de percer les mystères de l’océan.