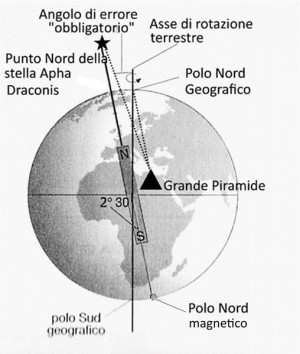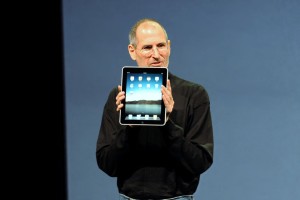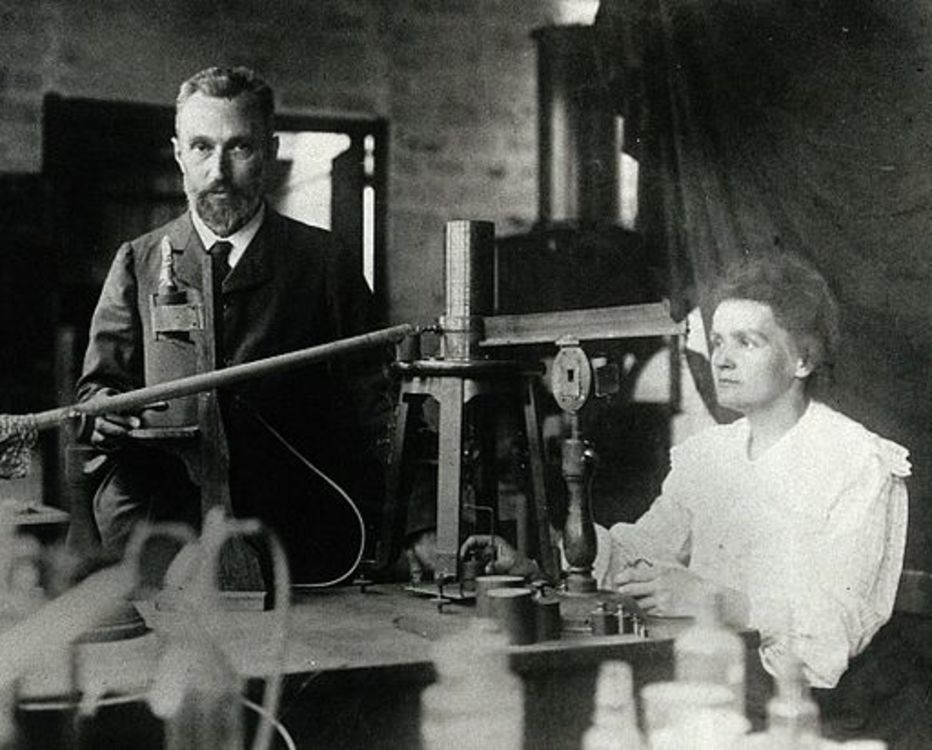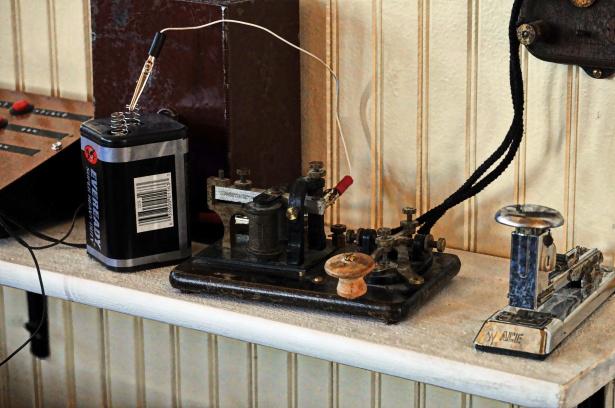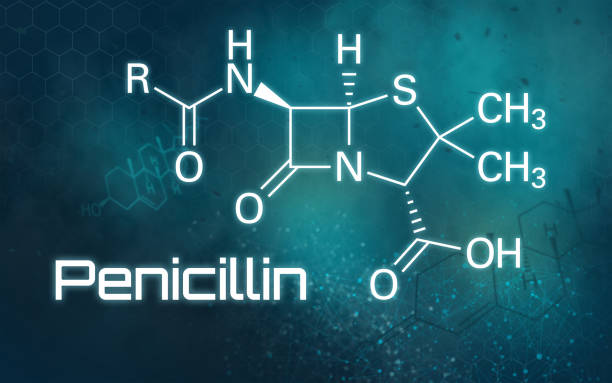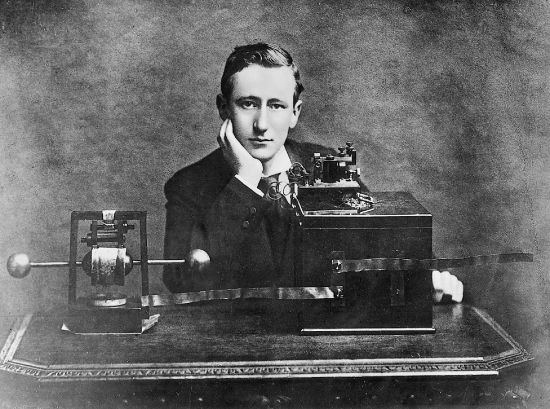Contrairement à une idée reçue souvent relayée, les savants de l’Antiquité savaient déjà que la Terre est sphérique. Loin d’être une découverte moderne ou une vérité révélée uniquement par les voyages de Christophe Colomb, la rotondité de notre planète est une certitude acquise depuis plus de deux millénaires. Explorons ensemble les preuves, les démonstrations et les penseurs qui ont façonné cette connaissance bien avant l’ère moderne.
Une idée qui remonte à l’Antiquité grecque
Les premières intuitions des philosophes présocratiques
Dès le VIe siècle avant notre ère, certains penseurs grecs commencent à envisager que la Terre pourrait être sphérique. Parménide, puis Pythagore, sont parmi les premiers à proposer cette idée. Pythagore, influencé par l’harmonie des formes géométriques, pensait que la sphère était la forme parfaite, et que l’univers, y compris la Terre, devait donc adopter cette géométrie idéale.
Platon et la forme du monde
Au IVe siècle av. J.-C., Platon reprend l’idée pythagoricienne : dans son œuvre "Le Timée", il décrit la Terre comme une sphère, forme parfaite attribuée par le créateur à un monde ordonné. Pour lui, cette sphéricité découle d’une logique cosmologique et métaphysique.
Aristote et les premières preuves empiriques
Mais c’est Aristote (384-322 av. J.-C.) qui apporte les premières preuves rationnelles de la rotondité de la Terre. Dans son traité "Du ciel", il avance plusieurs arguments :
-
L’ombre de la Terre sur la Lune pendant les éclipses est toujours ronde.
-
En voyageant vers le sud, on voit apparaître des étoiles qui ne sont pas visibles plus au nord, ce qui implique une courbure de la surface terrestre.
-
Les navires disparaissent progressivement à l’horizon, d’abord la coque, puis les mâts, preuve que la surface est incurvée.
Ces observations sont simples, mais puissantes, et elles constituent des indices empiriques en faveur d’une Terre sphérique.
Ératosthène : le premier à mesurer la circonférence de la Terre
Une expérience de génie au IIIe siècle av. J.-C.
Ératosthène de Cyrène (276-194 av. J.-C.), bibliothécaire en chef à Alexandrie, ne se contente pas de croire que la Terre est ronde : il tente d’en mesurer la circonférence. Il remarque que, à Syène (l’actuelle Assouan), le Soleil est à la verticale le 21 juin, alors qu’à Alexandrie, à la même date, un bâton planté dans le sol projette une ombre.
En mesurant l’angle de cette ombre (environ 7,2°) et connaissant la distance entre les deux villes (environ 800 km), il en déduit que la circonférence de la Terre est de 40 000 km, ce qui est extrêmement proche de la valeur réelle (40 075 km).
Cette démonstration est un exploit scientifique majeur, basé sur l’observation, la géométrie et le raisonnement logique. Et ce, plus de 1700 ans avant que Christophe Colomb ne prenne la mer !
La vision sphérique dans le monde romain et médiéval
Une connaissance transmise dans l’Empire romain
Les savants romains, comme Pline l’Ancien ou Claude Ptolémée, ont repris et diffusé les travaux grecs. Dans son "Almageste", Ptolémée considère la Terre comme une sphère au centre de l’univers. Même si son modèle est géocentrique, il n’y a aucun doute sur la rotondité terrestre.
La carte du monde de Ptolémée (IIe siècle ap. J.-C.), bien qu’inexacte, repose sur l’idée d’une Terre ronde et permet une représentation globale de la planète connue à l’époque.
Une idée jamais vraiment oubliée au Moyen Âge
Contrairement à une idée reçue, les savants du Moyen Âge ne croyaient pas que la Terre était plate. Dans les universités médiévales, on enseignait encore les textes d’Aristote et de Ptolémée. Thomas d’Aquin, philosophe scolastique du XIIIe siècle, parle d’une Terre sphérique dans ses traités.
Les navigateurs eux-mêmes, au XVe siècle, étaient conscients que la Terre était ronde. Le débat n’était pas sur la forme de la Terre, mais sur la distance à parcourir pour atteindre l’Asie en naviguant vers l’ouest, point sur lequel Christophe Colomb s’était largement trompé.
Les voyages de l’époque moderne : confirmation visuelle
L’expédition de Magellan : un tour du monde révélateur
C’est entre 1519 et 1522 que l’expédition de Fernand de Magellan (complétée par Juan Sebastián Elcano après la mort de Magellan) effectue le premier tour du monde. Ce voyage, bien que périlleux, prouve concrètement qu’en naviguant toujours vers l’ouest, on peut revenir à son point de départ.
Cela ne fait que confirmer une certitude ancienne : la Terre est bien une sphère, et non un disque plat.
Une idée ancienne, mais des résistances modernes
Les théories platistes actuelles : retour de l’irrationnel
Malgré les preuves abondantes, des théories platistes refont surface à l’ère d’Internet. Ces croyances reposent souvent sur des raisonnements pseudo-scientifiques ou des méfiances envers les institutions.
Pourtant, comme le disait déjà Ératosthène, « il n’est de pire ignorance que de refuser d’observer ce que l’on voit ».
La science moderne renforce ce que l’Antiquité avait pressenti
Grâce aux satellites, aux photos depuis l’espace, à la géodésie et à l’astronomie, la rotondité de la Terre est aujourd’hui une évidence. Mais il est fascinant de constater que cette vérité, que nous considérons comme acquise, était déjà solidement argumentée plus de 2 000 ans avant notre époque.
Une certitude vieille de plus de deux millénaires
La Terre est ronde : ce n’est pas une révélation moderne, mais une vérité antique, démontrée avec brio par les philosophes et savants grecs. Loin d’être des ignorants, nos ancêtres ont su observer, raisonner et mesurer pour parvenir à une conclusion que la science contemporaine ne fait que confirmer. Une belle leçon d’humilité et de continuité intellectuelle.