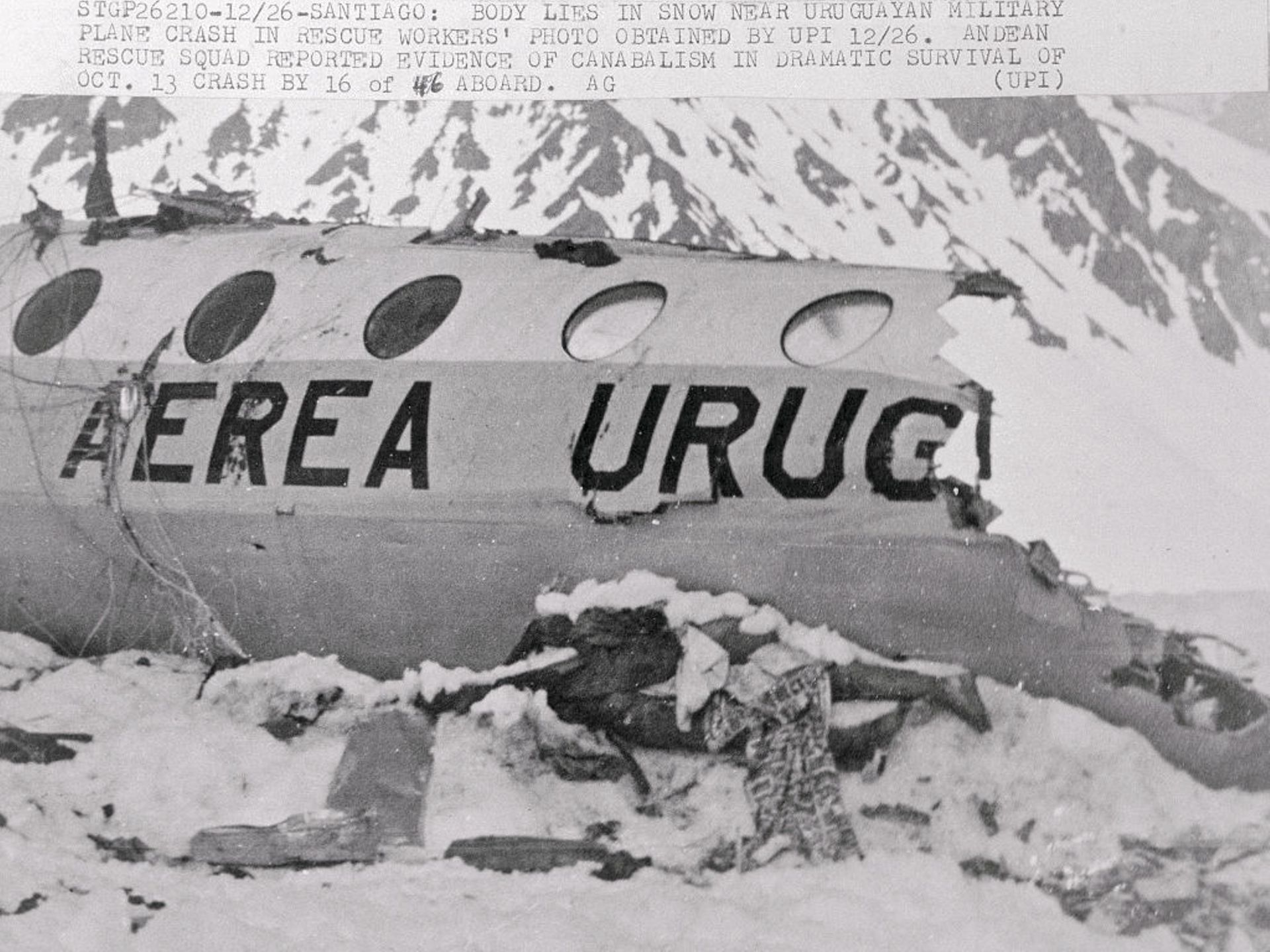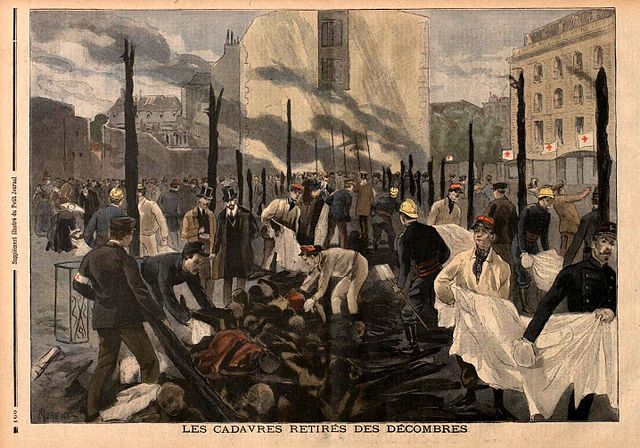Le 16 octobre 1984, le corps sans vie du petit Grégory Villemin, âgé de 4 ans, est retrouvé les poignets et les chevilles liés, dans la Vologne, une rivière des Vosges. Quatre décennies plus tard, cette affaire non résolue reste l’un des plus grands mystères judiciaires français. En 2024, soit 40 ans après les faits, de nouvelles expertises relancent l'enquête. Retour sur une affaire hors norme, entre drame familial, défaillances judiciaires et fascination collective.
Un crime qui choque la France entière Une scène insoutenable Le 16 octobre 1984, Grégory Villemin disparaît devant chez lui à Lépanges-sur-Vologne. Quatre heures plus tard, son corps est retrouvé dans la rivière, ligoté et sans vie. L’onde de choc est immédiate. Les médias s’emparent de l’affaire, et toute la France est bouleversée. Peu après, la famille reçoit un appel glaçant : « J’ai pris le petit Grégory. Je l’ai mis dans la Vologne. » Ce crime est d’autant plus incompréhensible qu’il touche un enfant innocent, dans un village paisible. Les soupçons vont très vite se tourner vers l'entourage familial.
Le corbeau, figure centrale de l'enquête Depuis plusieurs années, la famille Villemin recevait des lettres anonymes et des appels menaçants. Celui qu’on surnomme le "corbeau" semblait nourrir une haine profonde envers Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. Ce climat délétère de suspicion et de jalousie familiale devient le terreau d’une enquête complexe.
Une enquête chaotique et médiatiséeLa mise en accusation de Bernard Laroche Dès novembre 1984, Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemin, est inculpé. Il est accusé sur la base du témoignage de sa belle-sœur, Murielle Bolle, âgée de 15 ans, qui déclare l’avoir vu avec Grégory le jour du drame. Mais elle se rétracte quelques jours plus tard. Le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemin abat Bernard Laroche d’un coup de fusil. Il sera condamné pour ce geste en 1993 à cinq ans de prison, dont un avec sursis. Ce rebondissement dramatique transforme l’affaire en fresque familiale sanglante, digne d’une tragédie grecque.
Christine Villemin dans la tourmente En juillet 1985, c’est Christine Villemin, la mère de Grégory, qui est mise en examen pour meurtre. Une expertise graphologique jugée contestable, couplée à un acharnement médiatique, la désigne comme suspecte. Elle est finalement innocentée en 1993 après un non-lieu. L’affaire, désormais noyée dans les fausses pistes, les conflits d’experts et les pressions médiatiques, entre dans une zone d’ombre.
Un cold case qui fascine toujours
Relances judiciaires dans les années 2000 et 2010 En 2000, l’affaire est officiellement classée, mais elle rebondit à plusieurs reprises. En 2017, de nouveaux examens ADN sont réalisés. Plusieurs membres de la famille élargie sont placés en garde à vue, notamment Murielle Bolle, qui est à nouveau entendue. Rien de concluant, mais l’espoir renaît. Un rapport d’expertise en 2021 affirme que le crime est collectif, orchestré par un « groupe familial » mu par la jalousie. Ce document relance l’idée d’un complot familial, déjà évoqué dans les années 80, mais jamais formellement prouvé.
2024 : les progrès scientifiques à la rescousse En 2024, pour les 40 ans du drame, la justice ordonne de nouvelles expertises ADN, notamment sur les cordelettes et les vêtements de l’enfant. Des techniques de pointe permettent désormais d’identifier des traces génétiques infimes. Les enquêteurs espèrent également exploiter des courriers anonymes restés inexploités. Des chercheurs en linguistique judiciaire sont mobilisés pour traquer l’identité du corbeau à travers son style d’écriture. Un magistrat chargé du dossier évoque : « Nous ne sommes pas si loin de la vérité. »
Un mythe judiciaire et sociologique Une affaire au croisement des passions françaises L’affaire Grégory n’est pas qu’un fait divers. Elle concentre des thématiques profondes : l’enfance sacrifiée, les conflits familiaux, la lutte de classes (Jean-Marie Villemin, ouvrier promu contre la jalousie de ses proches), les ratés de la justice, et la cruauté médiatique. Elle devient un prisme à travers lequel la France se regarde : ses espoirs de justice, ses peurs sociales, ses pulsions collectives.
Une affaire ancrée dans la culture populaire Livres, documentaires, séries : l’affaire du petit Grégory inspire les artistes et les journalistes depuis 40 ans. En 2019, une série documentaire Netflix relance l’intérêt international pour l’affaire. Les réseaux sociaux prennent le relais, avec leurs propres enquêtes citoyennes. Des milliers d’internautes analysent les lettres, les interviews d’archives, ou échafaudent des théories. L’affaire devient presque un mythe contemporain, où chacun croit pouvoir résoudre le mystère.
Un espoir fragile mais intact
L’attente d’une vérité judiciaire Aujourd’hui, 40 ans après, les parents de Grégory, Jean-Marie et Christine Villemin, vivent toujours dans l’attente d’un début de vérité judiciaire. Ils espèrent que la science ou une révélation posthume (comme une lettre de confession) viendra briser le mur du silence. Leur dignité, leur silence depuis des années, leur force devant l’adversité suscitent l’admiration d’une grande partie de l’opinion publique. Une affaire qui parle à toutes les générations Les jeunes générations, qui n’ont pas connu l’affaire en direct, la découvrent avec stupeur. Cette longévité médiatique prouve que l’affaire dépasse le simple cadre criminel : c’est une tragédie humaine, un drame universel qui continue d’émouvoir et de questionner. ## Le mystère persiste, mais la mémoire demeure L’affaire du petit Grégory n’est pas une affaire comme les autres. C’est un traumatisme national, un drame à la fois intime et collectif. Quarante ans plus tard, ni le temps ni l’oubli n’ont effacé le visage du petit garçon au pull bleu. L’enquête judiciaire suit son cours, mais la mémoire, elle, est intacte.